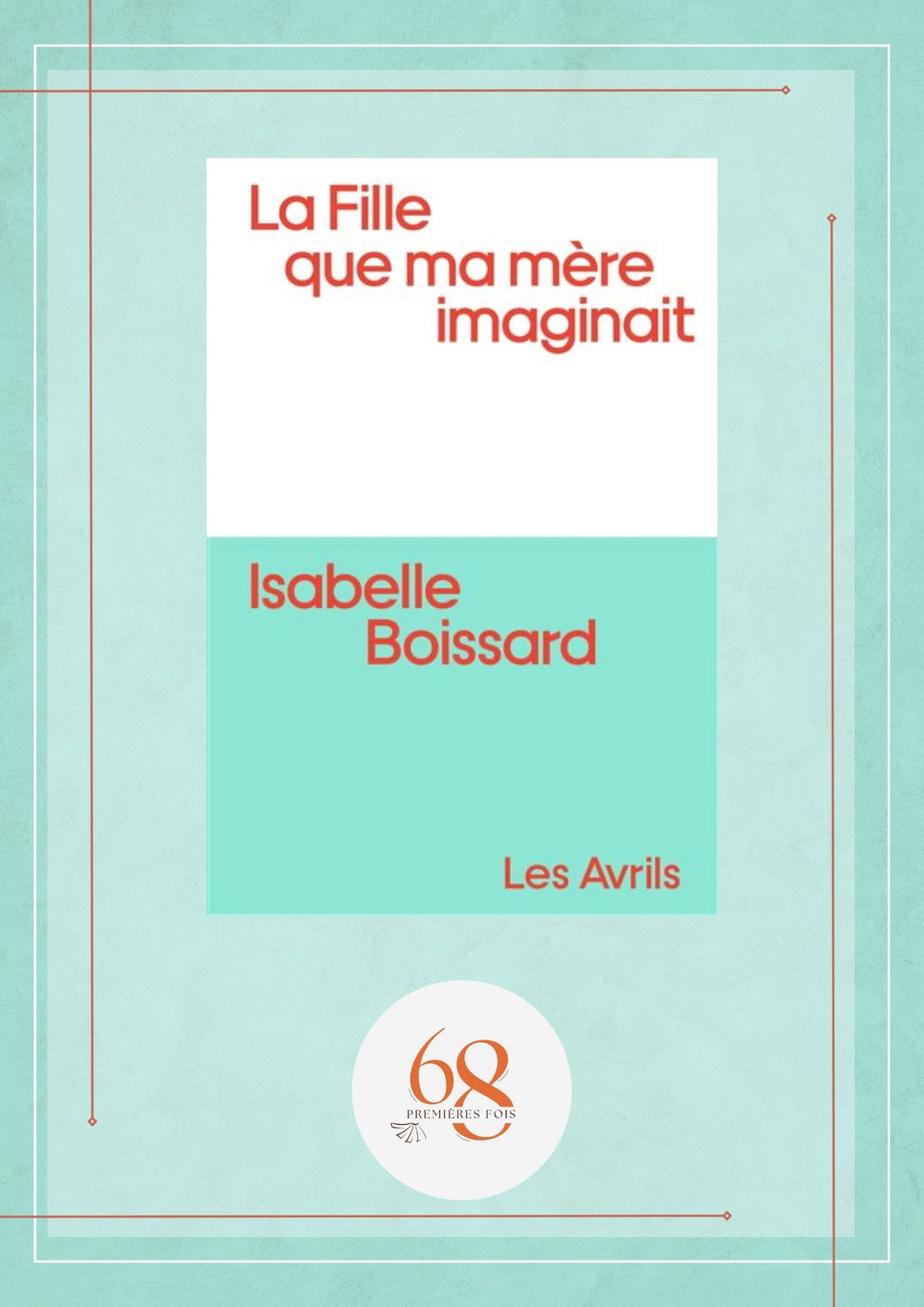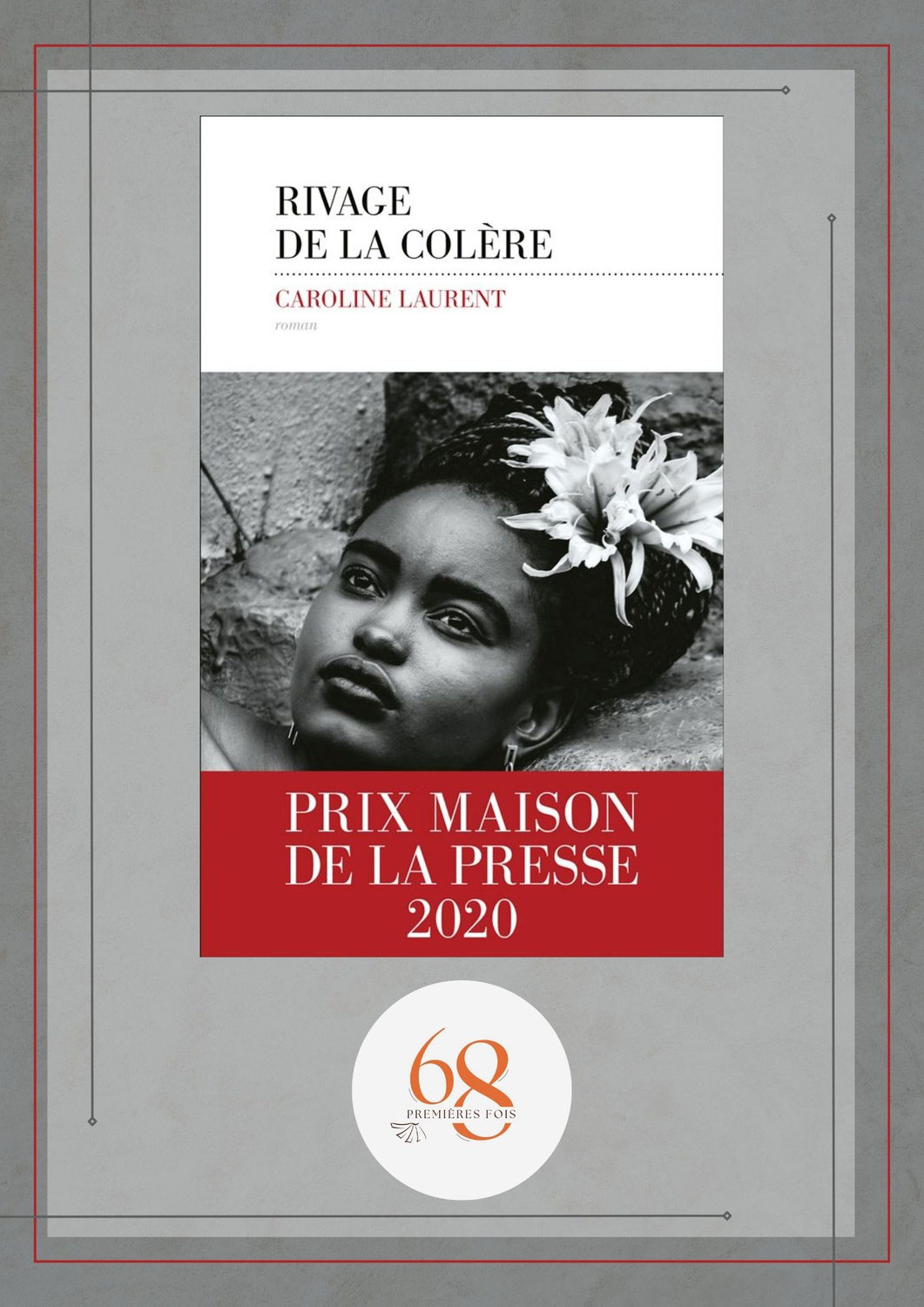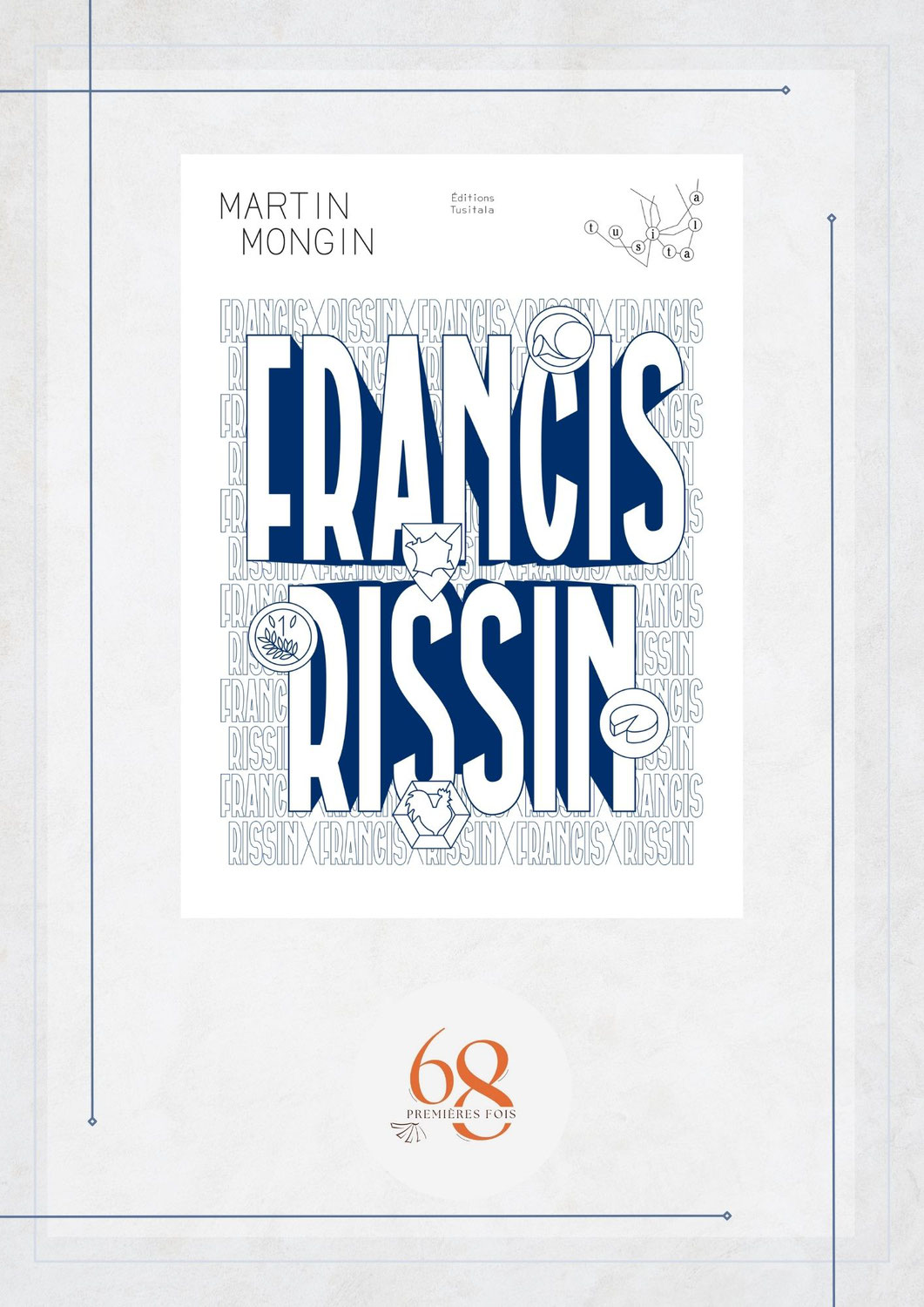Carnet de lectures · 18 avril 2024
D’après une histoire vraie. Le Gardien de Téhéran retrace la vie d'un homme ordinaire au destin extraordinaire dans un pays à l’histoire récente tumultueuse. Ce roman fort bien documenté couvre 5 décennies et tisse l’histoire singulière d’un homme modeste, discret et peu cultivé à celle d’un musée et à celle, plus large, d’un pays dont Stéphanie Perez restitue toute la complexité. À lire avec l'actualité iranienne en tête.
Carnet de lectures · 18 mai 2023
Ceux qui restent, ce sont au premier chef ceux qui reviennent des combats sains et saufs. Ceux qui restent, ce sont les parents, épouses, enfants, amis qui continuent à mener une vie dite normale. Quand le caporal Guyader s'évapore alors qu'il devait repartir en mission, quatre de ses frères d'arme se lancent à sa recherche. Terriblement humain, Ceux qui restent a l'intelligence de ne pas faire de ces hommes des héros invincibles et offre la possibilité de lectures multiples. Pas mal du tout.
Carnet de lectures · 06 mars 2023
Même s’il a la brutalité sans fard du quotidien et d’un réel qui n’épargnent rien, Fuir l'Eden d’Olivier Dorchamps n’est pas qu’un livre sur les tourments sociaux qui prennent les gens en étau entre terreur et banalité. C’est un roman d’espoir, d’amour et de survie, porté par la voix incandescente d’Adam, jeune garçon en équilibre entre enthousiasmes et doutes, qui refuse le caractère implacable des jours. Magnifique et prenant jusque dans ses dernières pages.
Carnet de lectures · 04 mai 2022
La Fille que ma mère imaginait est le premier roman d'Isabelle Boissard, paru aux Avrils il y a un an. Il prend la forme d'un journal intime, tenu deux-trois mois par Isabelle, fraîchement expatriée à Taipei avec son mari et ses deux filles. Le ton, volontiers caustique et cash, affiche la liberté qui manque à la narratrice, courant le risque de masquer parfois la profondeur du propos.
Carnet de lectures · 13 avril 2021
Pour son 1er roman, Bénie soit Sixtine, la journaliste toulousaine Maylis Adhémar s’empare d’un sujet délicat (comprenez casse-gueule !) : l’intégrisme religieux dans les familles catholiques, thème quelque peu oublié en littérature. Cette histoire d'une jeune mère qui chemine vers la lumière et s'émancipe évite les lieux communs et la caricature. La construction est impeccable, le propos implacable. Un 1er roman très réussi.
Carnet de lectures · 04 février 2021
Comment vous parler du 1er roman de Johanna Krawczyk, Avant elle, sans faire assaut d’éloges dithyrambiques à vous faire lever le sourcil de méfiance ? Un 1er roman certes, mais aussi le roman d’une autrice passée par l’écriture de scénarios. Et cela se sent dans son habilité consommée à saisir le lecteur, le plier à sa volonté, le berner avant de le tordre et l’amener là où il ne veut surtout pas aller pour enfin le relâcher, le souffle court, les yeux rougis, la gorge serrée.
Carnet de lectures · 25 juin 2020
Avec une 4e de couv’ aussi affriolante qu’une liste de poncifs pour intrigue à deux balles, En moins bien, 1er roman d’Arnaud Le Guilcher, aurait de quoi décourager les lecteurs. Pourtant, sous ses airs débraillés d'histoire écrite à la va-comme-je-te-pousse, ce roman désabusé et cocasse est d’une émouvante générosité pour les losers de tous poils.
Carnet de lectures · 30 avril 2020
Rivage de la colère est le 2e roman de Caroline Laurent que j'avais repérée lors de la parution de Et soudain la liberté. Mais peut-on parler de roman quand l'autrice, franco-mauricienne, vient fouir dans l’histoire de sa famille pour nourrir son récit ? Les Chagos, petit archipel de l'océan Indien, étaient pour moi une terra incognita. L'indépendance de Maurice a arraché les Chagossiens à leur terre qu'ils peinent encore aujourd'hui à retrouver. Tragique et révoltant.
Carnet de lectures · 04 février 2020
Tout a déjà été écrit sur Francis Rissin, 1er roman de Martin Mongin. Qu’il est déroutant, ébouriffant, d’une ambition folle, audacieux, incroyable, labyrinthique, virtuose, jubilatoire, hypnotique, etc. Et tout cela est vrai, strictement vrai. Francis Rissin, c’est un pavé – pas seulement à cause de ses 616 pages - dans la rentrée littéraire de septembre ; un pavé qui a le bon goût de venir rider la surface de la belle endormie qu'est, parfois, la production littéraire française.
Carnet de lectures · 21 novembre 2019
J’ai cru qu’ils enlevaient toute trace de toi est un 1er roman d’un souffle rare, bouleversant, puissamment écrit. Non, le roman de Yoan Smadja n’est pas un récit de plus, le récit de trop, sur le génocide Tutsi de 1994. Ce roman est un modèle de texte sur l’intensité de destins personnels, la destinée d’un pays, l’histoire de personnes prises dans la tourmente écœurante de l’Histoire, sans jamais tomber dans le pathos grandiloquent, l’empathie facile, le voyeurisme gratuit.
Politique de confidentialité | Politique des cookies
∷ ©2016-2025 ⩫ Calliope Pétrichor ⩫ Tous droits de reproduction réservés ∷
∷ ©2016-2025 ⩫ Calliope Pétrichor ⩫ Tous droits de reproduction réservés ∷